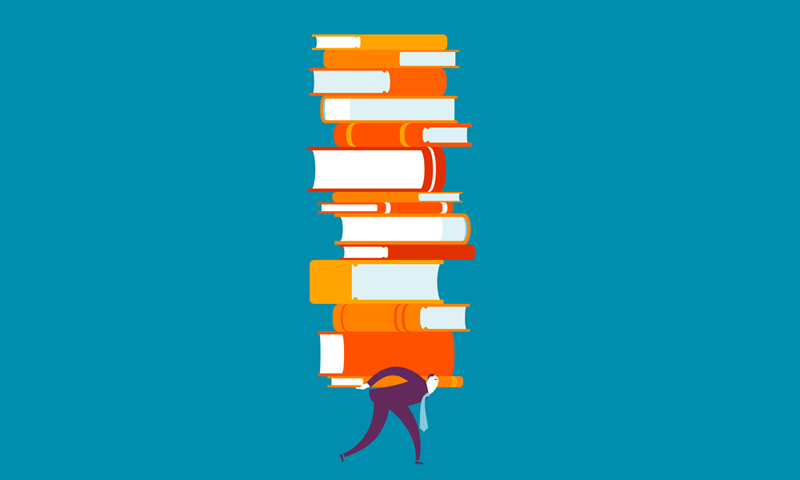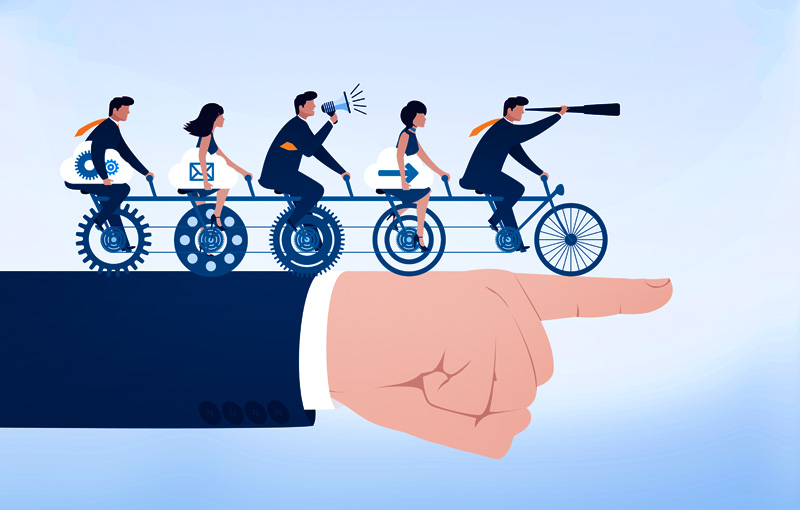L’histoire du XXe siècle confirme que la moitié de l’Europe a succombé à l’autoritarisme dans les années 20 et 30. La démocratie occidentale est devenue surchargée d’obligations et dominée par les groupes d’intérêt. Le correctif qui s’impose, révélé par l’histoire du XXe siècle, est que les règles constitutionnelles qui la régissent la circonscrivent rigoureusement. La question première à se poser reste toujours celle de définir son rôle à l’État, pour ensuite l’encadrer de règles qui interdisent le gonflement dont il a fait l’objet au XXe siècle. Force nous est de reconnaître que l’étendue de l’intervention étatique est la mesure de notre échec comme animal social. L’explosion des «droits sociaux» depuis la deuxième guerre mondiale constitue le problème essentiel de l’État moderne. C’est lorsque le commerce entre les hommes devient impraticable que l’État est appelé à intervenir. La coercition d’État est un mal nécessaire aux sociétés libres. Mais il faut voir dans l’explosion de l’étatisme à travers l’Occident depuis cinq décennies, l’expression incontestable de la faillite de nos relations humaines, de notre humanisme. Le vieillissement de la population n’incite guère à l’optimisme à cet égard.
Le moment est venu de persuader les votants et les gouvernements eux-mêmes de mettre un terme à la tendance naturelle de l’État à se gonfler. Significations pratiques? Elles sont trop vastes pour s’insérer intégralement dans ces lignes. Quelques illustrations suffiront. La Suède s’est engagée à équilibrer son budget sur l’étendue des cycles économiques. L’introduction de clauses d’expiration aux lois et aux régulations se conçoit aussi. Un régime où les lois et règlements expireraient après 10 ans ne manquerait pas de freiner la poussée des dépenses en imposant aux gouvernements eux-mêmes de se contrôler. En se rappelant que l’exercice de la politique monétaire par la Banque Centrale s’est avéré une heureuse évolution, on est tenté de retirer aux politiciens certaines décisions pour les confier aux technocrates. L’autorité des banques centrales a abaissé le taux d’inflation en Occident de plus de 20 pour cent en 1980 à près de zéro aujourd’hui. Dans ce contexte, le danger d’évoluer vers la technocratie serait réel; ce qui justifierait le recours calculé et circonscrit à cette formule à un nombre limité de décisions, comme par exemple les pensions. La concession aux autorités locales de fonctions plus nombreuses irait dans le même sens[1][1]. Mais la suggestion la plus puissante découlant de notre analyse consisterait à imposer des règles plus restrictives aux législateurs: par exemple la règle de décision à plus de 50 pour cent des assemblées législatives, aux deux-tiers ou plus, dans toutes les décisions susceptibles de gonfler les budgets et les contraintes aux citoyens. L’adoption de compressions aux budgets et à la fiscalité, elle, se maintiendrait à 50 pour cent. La tâche assignée ne sera pas facile, mais le coût de l’inaction à long terme serait énorme. L’avantage de cette sorte de réforme serait par contre imposant. La société qui l’adopterait prendrait l’avance sur ses voisines aux plans humains et économiques. L’accès à la liberté et aux droits de l’individu constitue la tradition qui a propulsé l’Europe d’abord, les États-Unis ensuite, vers le progrès et la richesse. A cet égard, le Québec étant l’une des communautés qui a le plus souffert de l’étatisme, il a le plus à gagner à réinventer l’État.
Dans son histoire récente, la société québécoise a particulièrement misé sur l’appareil orwellien de l’État pour réaliser le progrès et la prospérité, en gâtant les riches «baby boomers» de son excessive générosité. Elle a, plus que presque partout ailleurs, combiné le vieillissement de la population et la poussée des coûts de la santé. La vision élitique et discréditée qui a présidé à la révolution dite tranquille, mais qu’on qualifierait mieux de bureaucratique, a entrainé la société québécoise à sa suite, en faveur de l’amplification de nos retards et de l’émigration consécutive. L’occasion est venue de persuader les votants et les gouvernements d’accepter les contraintes constitutionnelles à la tentation naturelle de l’État de se gonfler. La consigne est claire: moderniser, par des règles du jeu pragmatiques, une institution étatique surchargée de responsabilités qui ne lui reviennent pas.
[1][1] Le gouvernement québécois projette déjà d’abaisser ses subventions aux municipalités de 300 millions.