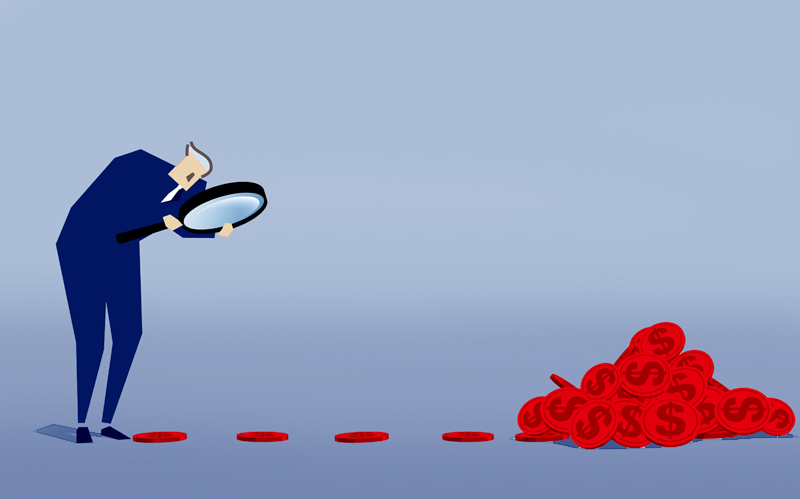La monopolisation de la production suscite l’apparition d’une rente, d’un profit, d’un surplus que quelqu’un voudra s’approprier. L’apparition de surplus suscite la convoitise. Elle donne lieu à ce que l’économiste désigne comme la course aux rentes, de la part de toutes sortes d’intérêts qui gravitent autour de l’industrie monopolisée.
L’une des constantes observées dans l’histoire de la monopolisation sectorielle veut que la cartellisation d’un secteur d’activité par l’étatisation favorise la monopolisation syndicale, c.-à-d. l’apparition d’un cartel des acteurs, soucieux de s’approprier sa part du surplus découlant de la concentration accrue de la structure de production.
Le principal obstacle à la modernisation de l’État réside souvent dans les syndicats du secteur public, qu’il s’agisse des enseignants, chez nous comme aux États-Unis ou des travailleurs du rail en France. En raison de sa structure centralisée, à l’image des vieilles entreprises industrielles, les firmes publiques sont plus faciles à organiser pour un monopole syndical que leur contrepartie privée. On a pu observer cette implication de l’analyse dans les secteurs de l’éducation, de la construction, du transport, de la santé, des télécommunications, de l’agriculture et ailleurs.
Dans certains cas, c’est le législateur lui-même qui a imposé la formation d’un monopole professionnel de représentation, comme dans l’éducation, la santé, l’agriculture et les corporations professionnelles. Le syndicalisme est devenu, au Québec et ailleurs, un phénomène étatique. Alors qu’un employé du secteur privé sur cinq appartient à un monopole syndical au Canada, le pourcentage grimpe à trois sur quatre dans le secteur public.
Le dénominateur commun de la plupart des grèves qu’on observe au Canada est qu’elles surviennent dans le secteur public. Il ne se passe pas d’années sans qu’on soit témoin ou victime d’une grève des enseignants, des infirmières, des fonctionnaires, des diffuseurs de Radio-Canada, quelque part au Canada. Pas étonnant puisque le gros des monopoles syndicaux s’observe dans le secteur public.
Dans l’ensemble du pays, les employés publics comptent pour 18% de la main-d’œuvre mais pour plus de la moitié des jours perdus en grève dans une année type. Certains analystes estiment même que la production publique devient dans ce contexte, non pas une activité au service de la population consommatrice, mais plutôt une machine à fabriquer des jobs et des conditions favorables aux syndiqués. (R. Breton, 1999).
Que se passe-t-il dans les secteurs ainsi cartellisés? En l’absence de monopolisation du secteur, la menace toujours constante d’apparition d’employeurs libres de syndicats sert de frein aux demandes syndicales. La crainte d’attirer des producteurs concurrents, advenant que les salaires et donc les prix s’élèvent démesurément dans les firmes syndiquées, contribue à modérer les ambitions du monopole syndical.
Par contre, si l’étatisation limite l’entrée de producteurs concurrents, la contrainte au gonflement des salaires s’en trouve supprimée aux yeux du monopole syndical. La poussée des salaires et la compression de l’emploi suivent par la force des choses. En général, les salaires des syndiqués du secteur public, composantes importantes du coût ou du prix, montent plus rapidement que ceux du secteur privé. (Ferris et West, 1999).