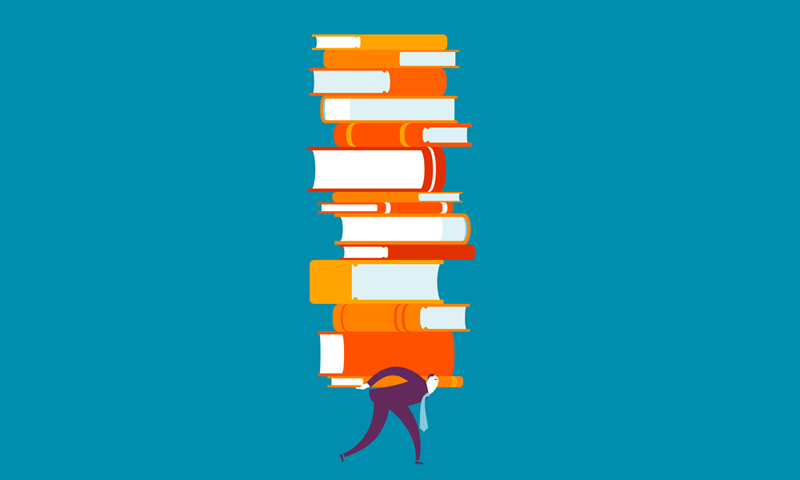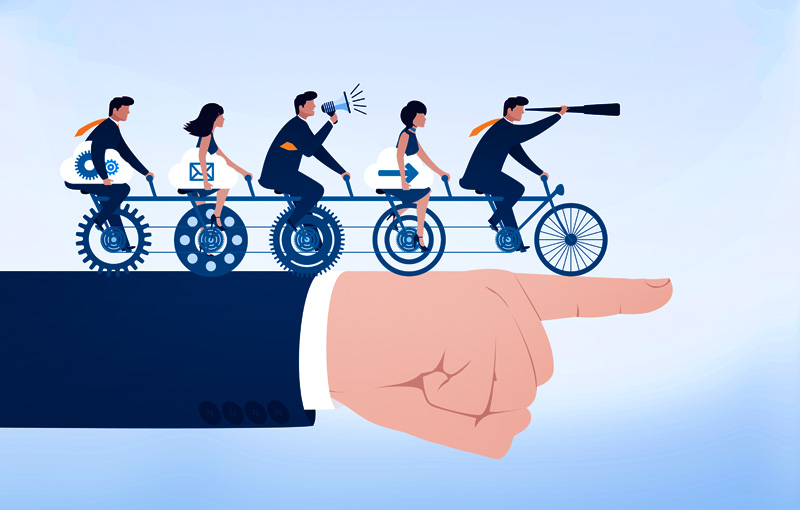Les énormes pertes issues des réglementations sectorielles généralisées dans l’agriculture, les transports, les communications, etc., ne perdent leur caractère dramatique que lorsqu’on les compare à la succession d’interventions réglementaires et fiscales qui se sont abattues sur la main-d’œuvre depuis 40 ans. Normes arbitraires du travail, dont le salaire minimum, préavis de licenciement, discrimination active, qui repose sur le sexisme et le racisme en ce que l’assignation des personnes se fait, non plus en fonction des talents de l’individu, mais plutôt de la couleur de sa peau ou du sexe, renforcement des monopoles syndicaux (le taux le plus élevé de monopolisation syndicale du continent), fiscalité du travail, alourdie de 530% depuis 1980. L’aboutissement est incontournable: le marché du travail est bloqué: le chômage se maintient à des niveaux en permanence alarmants.
Si on exclut les règles qui régissent la sous-traitance, le Québec est affublé du marché du travail le plus rigide en Amérique du Nord. C’est ce qu’établit une récente étude de l’Institut Fraser (Fraser Forum, septembre 2004), qui compare la performance du marché du travail au cours des années 1998-2002, à travers les 10 provinces canadiennes et les 50 États américains. L’étude met en parallèle quatre critères de performance du marché de l’emploi: 1. Le taux de chômage, à 9,1%, place le Québec au 53e rang sur 60 juridictions; 2. Le Québec est bon dernier des 60 juridictions pour la durée du chômage pour ses victimes, à 26,8 semaines (11,1 en Alberta, 20,8 semaines en Ontario); 3. La productivité du travail ou la valeur de la production réalisée par travailleur, à 64 282$, (91 565 en Alberta, 72 571$ en Ontario), place le Québec à la 52e place en Amérique; la productivité moyenne des travailleurs dans les juridictions les plus syndiquées s’inscrit à 64 888$, tandis qu’elle se hissait à un niveau de 30% supérieur (83 945$) dans leurs contreparties moins syndiquées ; 4. En matière de croissance de l’emploi dans le secteur privé, 6 provinces (dont l’Alberta et l’Ontario) font mieux que le Québec, en dépit de la bonne conjoncture générale du Canada relativement à l’économie américaine pendant cette période.
Au total donc, l’indice global de performance place le Québec au dernier rang des provinces canadiennes (10e rang) avec un score de 1,9 sur 10,0 et au 55e rang sur 60 dans le classement Canada-USA. Seules l’Ontario (5,5), l’Alberta (7,5) et le Manitoba (5,1) obtiennent au Canada une note de passage, c.-à-d. supérieure à 5,0.
Hausse de salaires des syndiqués, baisse de l’emploi
Demandons-nous maintenant pourquoi ce piètre bilan s’observe. Il faut poser au départ que le marché du travail ne diffère pas essentiellement du marché des « peanuts ». Lorsque le prix du travail s’élève, les employeurs en achètent moins. On engage moins de briqueteurs à $32, qu’à $18. Les salaires syndiqués élèvent le coût de la main-d’œuvre et donc de la production, dépriment l’emploi et forcent les candidats déboutés à se déverser dans les secteurs non syndiqués, où ils tirent les salaires vers le bas et le chômage vers le haut. Ce sont donc les non syndiqués (et ultimement les consommateurs) qui en portent le coût en emplois et salaires réduits. Or au cours des quarante dernières années, le marché du travail a été marqué par une succession ininterrompue d’interventions publiques qui ont eu pour double effet d’alourdir le coût du travail pour les employeurs et d’en déprimer le rendement pour les employés. L’aboutissement est incontournable: la croissance de l’emploi se ralentit et le chômage se maintient en permanence à un niveau supérieur. Au Canada, les salaires des syndiqués sont de plus de 30% supérieurs au salaire concurrentiel (de 18 à 20%, une fois normalisés en fonction de la formation et de l’expérience des travailleurs).