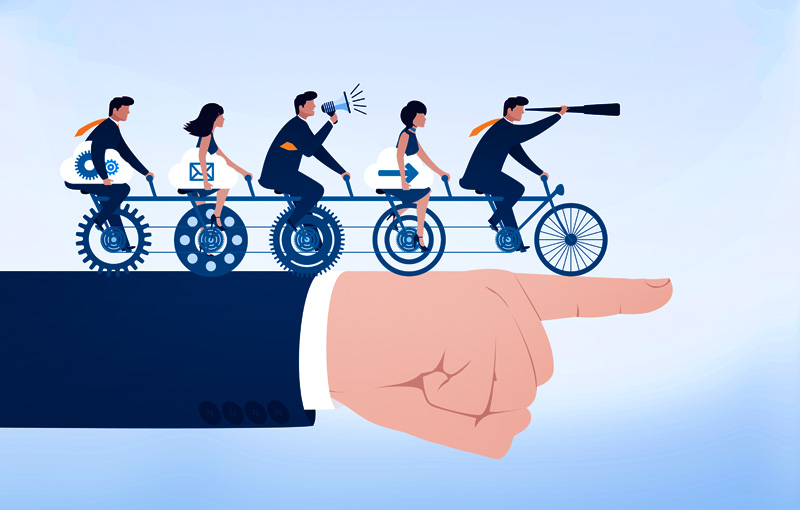On peut aller plus loin dans l’interprétation du protectionnisme. Posons d’abord que l’implantation du commerce libre hausse les salaires, c.-à-d. la rémunération du facteur le plus abondant qu’est le travail. Or les votants sont aussi des travailleurs. La démocratie semblerait donc conférer à une tranche élargie de la population le bénéfice de salaires accrus. On devrait prédire le recul du protectionnisme avec l’avènement du régime démocratique. Le fait est que depuis la deuxième guerre mondiale, les tarifs ont baissé. De 1981, année où le monde comptait une quarantaine de démocraties, à 2003 où leur nombre avait plus que doublé, le tarif moyen des pays sous-développés a diminué de plus de la moitié, soit de 30% à moins de 15% (Kono 2006). Ce résultat reste trompeur. L’instrument tarifaire a sans doute reculé, mais les autres formes de protectionnisme mieux déguisées ont connu une recrudescence inégalée dans l’histoire. On les désigne souvent dans le monde politique comme des «sauvegardes», des instruments de protection sanitaire, du contingentement, des droits antidumping ou même des «restrictions volontaires à l’exportation». La réalité est que, si les barrières tarifaires ont baissé, les autres barrières ont gagné du terrain. Selon les calculs de Kono, la part des importations touchée par ces variétés de protectionnisme a gagné sept points en pour cent. Vingt pour cent des importations font l’objet de dispositions sanitaires, contre seulement neuf pour cent il y a vingt-cinq ans.
L’interprétation analytique de cette évolution reste la même: l’obscurité dans laquelle baignent ces outils protectionnistes dans l’esprit des masses. Kono les décrit comme des formes politiquement «optimales d’obscurité». La masse des votants peut à peine les distinguer dans le déluge d’interventions qui caractérisent les choix publics contemporains. Le politicien libre-échangiste pourra peut-être convaincre l’électorat que ses adversaires choisissent de frapper son lait ou sa voiture de tarifs qui lui valent des prix exorbitants dans ses achats. De discerner l’impact ou la signification d’une mesure sanitaire ou antidumping devient une démarche plus subtile. Peut-on raisonnablement s’élever contre une politique qui vise à protéger la santé et la sécurité publique? Qui oserait publiquement sacrifier la tortue marine dans les filets de pêcheurs au profit de crevettes moins chères? Ces questions valent d’être posées, puisque les pays les plus soucieux de sécurité, de santé, de qualité et de pureté environnementale à la frontière, ne s’avèrent comme par hasard pas plus empressés d’appliquer les mêmes standards à l’intérieur. Dans la même veine, d’autres pays, comme le Mexique, se sont montrés particulièrement sévères à l’endroit du dumping pour gagner l’adhésion populaire au Traité de Libre-échange nord-américain.