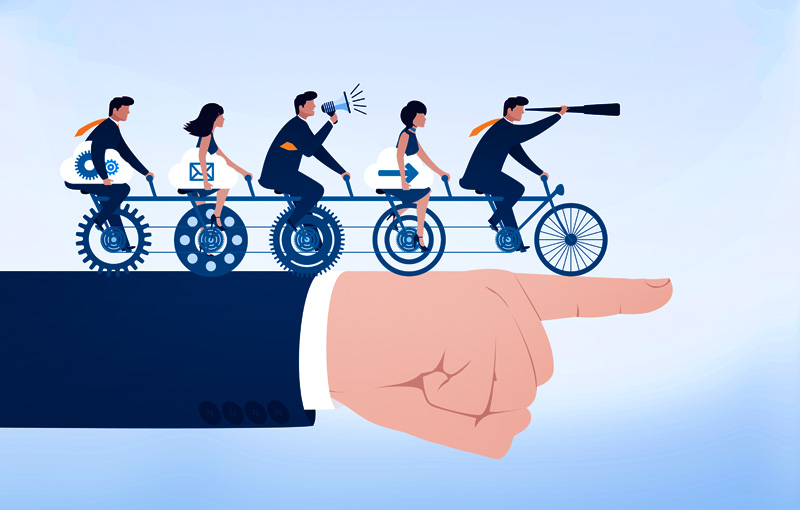On associe la plupart du temps l’interventionnisme d’État à la fiscalité et aux budgets de dépenses, dont la monopolisation publique directe. À bon droit. Mais la coercition d’État s’étend bien au-delà du poids fiscal. Il y a en particulier la régulation qui s’avère aussi lourde. Et la critique économique s’applique tout aussi bien aux activités réglementaires qu’aux budgets publics.
On entend par régulation l’imposition, par les gouvernements, de contrôles sur à peu près toutes les dimensions des entreprises et de nos vies professionnelles et personnelles, depuis nos contrats de mariage jusqu’à la grosseur des ouvertures dans les tétines de biberons d’enfants, aux images qu’on a le droit ou pas de regarder à la télévision, en passant par la quantité de lait qu’on a le droit de produire. La signification profonde de ce mécanisme réside dans le pouvoir qu’elle confère aux offreurs de se soustraire à la concurrence. C’est le régulé qui «capture» le régulateur et l’amène à régler ses décisions sur l’intérêt des producteurs aux dépens des consommateurs.
Toutes les régulations sectorielles qui concèdent le monopole à des entreprises particulières et perpétuent des raretés coûteuses et des prix artificiellement gonflés s’inscrivent dans la logique du transfert de richesse aux dépens des consommateurs. A l’ère de l’internet, le CRTC décrète en 2006 qu’il sera illégal pour les monopoles locaux de téléphone d’abaisser leur prix pour rivaliser avec la téléphonie par câble[1][1]. Il est interdit aux banques étrangères de concurrencer leurs contreparties canadiennes, à moins de constituer une entité distincte de la maison mère. La loi interdit la vente de margarine couleur beurre au Québec et les supermarchés doivent limiter leur personnel à quatre employés aux heures tardives du week-end pour protéger les dépanneurs. Wall Mart est victime d’un véritable jihad. Dans ses effets, cette forme de cartellisation, rappelons le, se distingue de la monopolisation publique pure en ce qu’elle diffuse le fardeau sur les consommateurs plutôt que sur les contribuables. Les industries les plus touchées se retrouvent dans l’agriculture (lait, volailles, céréales et œufs), dans l’industrie du taxi, de la téléphonie et de la radiotélévision, des institutions financières, de l’énergie dont le gaz naturel, dans le logement par le contrôle des loyers et, bien sûr, dans tout le marché du travail.
Jusqu’au milieu du dernier siècle, la population n’attendait pas grand-chose du gouvernement. Chacun pouvait mener sa vie suivant les principes personnels dictés par ses croyances et les contraintes qui l’encadraient. Les lois en vigueur n’affectaient pas immédiatement la vie des individus, ni celle de leurs entreprises. L’individu qui menait une vie honnête et s’employait à subvenir aux besoins de sa famille était jugé bon citoyen. Parce qu’elle vivait sous un régime de gouvernement limité, la population n’avait pas lieu de blâmer le gouvernement de ne pas régler les problèmes qui ne le regardaient pas. Cette convention implicite s’est rompue le jour où le législateur s’est avisé de poser que tout relevait désormais de sa responsabilité.
Désormais que les gouvernements prennent parti dans les affrontements qui divisent la population dans des matières morales qui touchent les gens dans leurs principes les plus profonds, l’aliénation se généralise. L’avortement, le port du turban dans la gendarmerie royale, du voile islamique à l’école publique, la discrimination active à l’endroit d’une multitude de minorités, le droit homosexuel dont le mariage entre gais, la langue d’affichage et de travail, les clauses du contrat de mariage, autant d’objets de controverse morale où le législateur prend parti contre la volonté de larges fractions de la population. À la maison ou au travail, une multitude de nouveaux risques physiques et psychologiques ont maintenant été identifiés, que notre ignorance présumée nous empêchait de reconnaître avant la clairvoyance, aussi présumée, du régulateur.
Tout employeur appréhende désormais de se retrouver en infraction d’une loi ou d’un règlement quelconque édicté par la CSST, le ministère de l’environnement, la Commission des droits de la personne, la police de la langue, et par quelques dizaines d’autres bureaucraties, dont les sous-fifres de l’équité dans l’emploi. Tout contribuable, individuel ou corporatif, doit craindre à tout moment d’avoir violé l’une ou l’autre des règles fiscales. Lorsque la prison guette l’agriculteur qui produit la quantité de lait qu’il juge optimale ou qui choisit de transporter ses céréales à la frontière, ou qui s’avise de cultiver des OGM, ou qui a recourt à la carabine pour se débarrasser de quelque encombrant rongeur protégé, il y a lieu de parler de harcèlement des citoyens.
A titre d’illustration de l’impact de la régulation, résumons le dernier travail paru sur la régulation des banques. (Barth, Caprio et Levine, 2006) Les auteurs établissent que la supervision des banques par l’autorité exerce un effet négatif sur leur développement, abaisse leur efficacité et élève la probabilité de crises financières. On découvre aussi que de hausser le ratio du capital au crédit offert par les banques n’exerce pas d’effet discernable. On peut aussi mesurer le fardeau de la régulation par son contraire : la dérégulation. Une étude récente s’emploie à examiner des épisodes de dérégulation survenus dans 7 industries (le transport aérien, le camionnage, le chemin de fer, les télécommunications, la poste et l’industrie du gaz et de l’électricité), dans 21 pays industriels, au cours de la période allant de 1975 à 1996. L’indice de régulation (difficulté d’accéder à une industrie, contrôle des prix, place de la propriété publique) retenu démontre que la régulation strictement industrielle a effectivement diminué au cours de la période dans certains pays, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. L’étude établit que la dérégulation a donné lieu à une expansion phénoménale des investissements dans les industries ainsi libérées, en conséquence de la baisse de prix et de la demande accrue, ainsi que par l’effet d’abaissement des coûts administratifs pour les firmes. En diminuant la régulation de 15%, on suscite l’expansion des investissements de 6 à 7%.
[1][1] Le Cabinet fédéral a par la suite renversé cette décision.