Le coût administratif des programmes publics: une fois et demie supérieur au coût des mêmes programmes privés.
Dans une perspective cartésienne, un régime de producteur public unique paraît plus simple. On a longtemps invoqué cet argument pour rationaliser l’étatisation. La suppression de la concurrence partout simplifierait a priori l’administration. Il en coûterait moins cher au distributeur d’essence s’il ne se trouvait qu’une station service par quartier ou par région, moins cher au super marché s’il n’existait qu’une variété de petits pois. L’ex-éditeur du New England Journal of Medicine fixait récemment à 150 milliards de dollars les économies à attendre de l’élimination des centaines d’assureurs qui servent le marché américain. Ces économies proviendraient, estime-t-il, de l’élimination des coûts administratifs, du profit, des frais de marketing.
Mais la question essentielle du débat pourrait se formuler comme suit : comment mesurer les frais administratifs pour établir une comparaison honnête? Le producteur public n’échappe pas aux fonctions qu’assume la firme commerciale. Il doit rembourser les fournisseurs de services, prélever les primes sous forme de taxes, exercer le contrôle sur leur utilisation. Aux frais directement comptabilisés, il importe donc d’ajouter le coût d’imposition et de prélèvement des taxes qui servent à le financer, de même que les fonctions de lobbying que constitue la course aux faveurs politiques. Des estimations ont été faites aux États-Unis pour identifier ces coûts cachés et les rapprocher de leur contrepartie publique associée aux programmes d’État Medicare et Medicaid. Elles ont donné les résultats suivants : Les deux programmes publics affectent 27 cents à l’administration pour chaque dollar de prestation qu’elles versent, ce qui implique des frais administratifs de 66% supérieurs à ceux de leur contrepartie privée par dollar de bénéfice. Une fois redressées les fausses conceptions, il apparaît que le coût administratif des programmes publics est d’une fois et demie plus élevé que celui des programmes privés. Et ce calcul n’incorpore pas le coût économique des distorsions que toute forme de prélèvement coercitif implique.
Les gagnants de la monopolisation publique
Comme le veut toujours la logique du monopole public et au-delà d’une majorité qui se fait payer les services par la minorité, la santé socialisée exploite les contribuables au profit de quelques groupes d’intérêt particuliers: les bureaucrates et les offreurs de services, dont les puissants syndiqués du secteur public, qui forment ce qu’un analyste appelait déjà en 1983 « le cartel bureaucratique de la santé » (Rosa, 1983). Les contribuables ne disposent pas de l’information nécessaire au contrôle du monopole; faute de concurrence, ils n’ont pas le moyen de comparer les services de différents offreurs. Les employés du monopole par contre exploitent l’ignorance rationnelle des victimes pour se valoir des rémunérations excessives. L’un des traits distinctifs des régimes de santé socialistes est de réserver un rôle et un pouvoir accru aux planificateurs et aux dispensateurs de services, aux administrateurs d’établissement et au personnel regroupé dans des syndicats. La « paix sociale » repose plus sur l’intérêt des groupes organisés que sur la satisfaction des patients. Comme éléments du processus de production, ces regroupements jouissent aussi d’une information privilégiée, relativement aux usagers, et même à leurs mandants les hommes politiques. La monopolisation publique les protège contre la concurrence, conditionnement qu’ils exploiteront à leur avantage. Les rentes de situation introduites par l’assignation de budgets globaux qui consacre la rupture entre l’output produit et les recettes obtenues, illustrent le phénomène. Il n’est pas sans intérêt de noter qu’au Canada le souci de réformer le système s’est estompé depuis que le gouvernement fédéral a recommencé à injecter massivement des ressources fraîches dans le système.
Profit de monopole aux syndiqués
La monopolisation de la production suscite l’apparition d’une rente, d’un profit, d’un surplus que quelqu’un voudra s’approprier. L’apparition de surplus suscite la convoitise. Elle donne lieu à ce que l’économiste désigne comme la course aux rentes, de la part de toutes sortes d’intérêts qui gravitent autour de l’industrie monopolisée. L’une des constantes observées dans l’histoire de la monopolisation sectorielle veut que la cartellisation d’un secteur d’activité par l’étatisation favorise la monopolisation syndicale, c.-à-d. l’apparition d’un cartel des acteurs, soucieux de s’approprier sa part du surplus découlant de la concentration accrue de la structure de production. Le principal obstacle à la modernisation de l’État réside souvent dans les syndicats du secteur public, qu’il s’agisse des enseignants, chez nous comme aux États-Unis ou des travailleurs du rail en France. En raison de sa structure centralisée, à l’image des vieilles entreprises industrielles, les firmes publiques sont plus faciles à organiser pour un monopole syndical que leur contrepartie privée. On a pu observer cette implication de l’analyse dans les secteurs de l’éducation, de la construction, du transport, de la santé, des télécommunications, de l’agriculture et ailleurs. Dans certains cas, c’est le législateur lui-même qui a imposé la formation d’un monopole professionnel de représentation, comme dans l’éducation, la santé, l’agriculture et les corporations professionnelles. Le syndicalisme est devenu, au Québec et ailleurs, un phénomène étatique. Alors qu’un employé du secteur privé sur cinq appartient à un monopole syndical au Canada, le pourcentage grimpe à trois sur quatre dans le secteur public. Le dénominateur commun de la plupart des grèves qu’on observe au Canada est qu’elles surviennent dans le secteur public. Il ne se passe pas d’années sans qu’on soit témoin ou victime d’une grève des enseignants, des infirmières, des fonctionnaires, des diffuseurs de Radio-Canada, quelque part au Canada. Pas étonnant puisque le gros des monopoles syndicaux s’observe dans le secteur public. Dans l’ensemble du pays, les employés publics comptent pour 18% de la main-d’œuvre mais pour plus de la moitié des jours perdus en grève dans une année type. Certains analystes estiment même que la production publique devient dans ce contexte, non pas une activité au service de la population consommatrice, mais plutôt une machine à fabriquer des jobs et des conditions favorables aux syndiqués. (R. Breton, 1999).
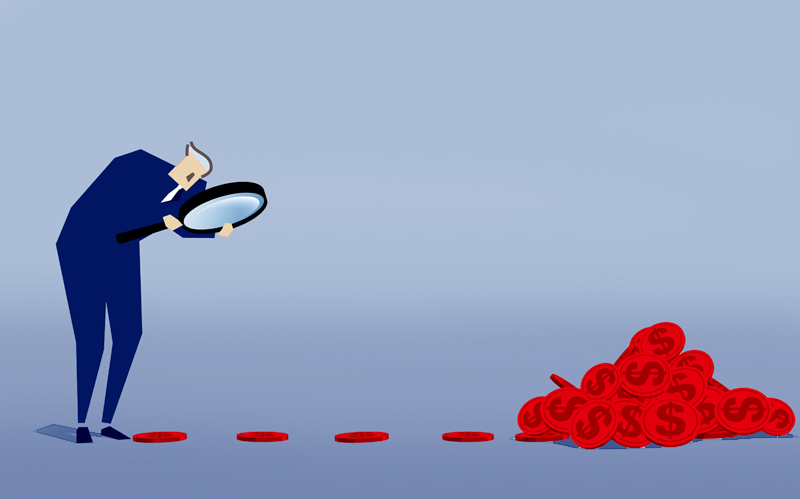
Laisser un commentaire